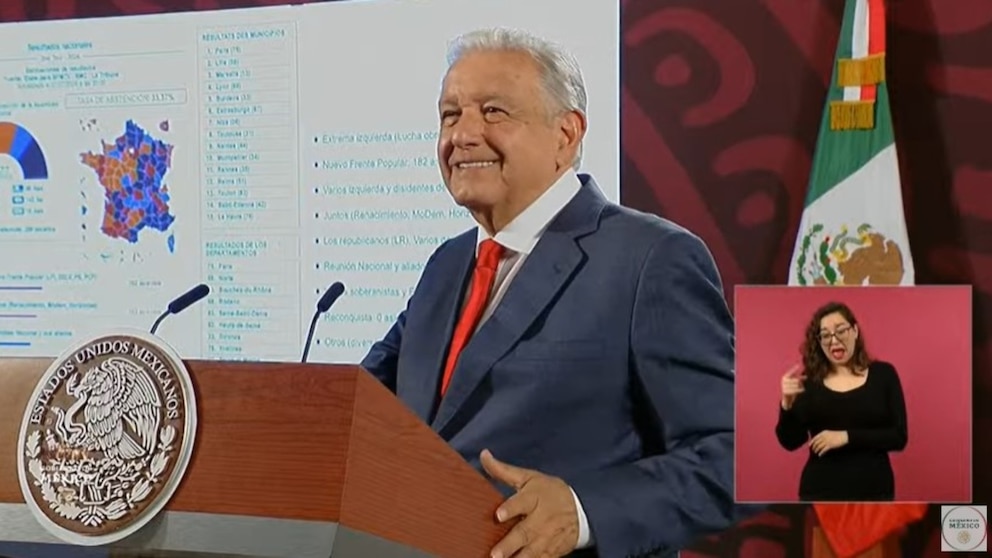Cet article est issu d’un travail universitaire réalisé dans le cadre de ma troisième année de licence d’Histoire parcours sciences politiques à l’Université de Poitiers. Il s’appuie sur un corpus d’articles scientifiques récents et propose une analyse critique du sexennat d’Andrés Manuel López Obrador (AMLO), président du Mexique de 2018 à 2024.
En revenant sur les politiques sociales, les choix économiques, la militarisation de l’État et les tensions démocratiques du mandat d’AMLO, ce texte interroge les contradictions internes à un projet politique qui se voulait en rupture avec le néolibéralisme.
Ce bilan invite aussi à réfléchir, à travers le prisme mexicain, aux défis de la gauche contemporaine : comment gouverner sans trahir ? Comment concilier redistribution sociale, transition écologique et approfondissement démocratique dans un monde encore structuré par les logiques du capitalisme globalisé ?
Le 2 juin 2024, Claudia Sheinbaum, ancienne maire de Mexico et membre du mouvement Morena, est élue à la présidence du Mexique. Première femme à accéder à cette fonction dans l’histoire du pays, son élection a immédiatement soulevé une question cruciale : incarnera-t-elle la continuité du projet politique d’Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ou marquera-t-elle un tournant dans la trajectoire du pays ? La victoire de Sheinbaum, à la tête d’une coalition issue de la « Quatrième Transformation » (Cuarta Transformación – 4T), prolonge en apparence l’ambition de refondation politique, sociale et économique lancée en 2018 par l’ex-président AMLO.
Dès son arrivée au pouvoir, ce dernier promettait une rupture avec les logiques néo-libérales et autoritaires des gouvernements précédents. Réforme de l’État, redistribution sociale, souveraineté énergétique, lutte contre la corruption, le discours de la 4T s’est construit comme une « nouvelle Révolution mexicaine ». Pourtant, après six ans de mandat, le bilan d’AMLO suscite de nombreuses interrogations. Si la popularité de l’ancien président est restée élevée, les tensions entre ambitions de justice sociale et les réalités politiques, économiques et sociales n’ont cessé de s’accumuler. Entre militarisation de la sécurité, centralisation du pouvoir exécutif et reproduction de certaines logiques extractivistes, la politique de la Quatrième Transformation semble avoir oscillé entre réforme et continuité. Ce qui nous amène à nous demander comment le sexennat d’Andrés Manuel López Obrador a-t-il essayé de rompre avec les logiques néolibérales et sécuritaires du passé ? Pour répondre à cette question, il faut interroger à la fois les transformations promises, les stratégies de gouvernement mises en œuvre, et les contradictions internes à ce projet politique. À travers une lecture croisée des politiques sociales, des recompositions politiques et des choix sécuritaires du gouvernement mexicain, cet article propose un bilan critique du sexennat d’AMLO (2018-2024) à la lumière de la Cuarta Transformación.
Une ambition de transformation sociale et politique en rupture avec le passé
Dès 2018, Andrés Manuel López Obrador a présenté son programme comme une « révolution pacifique » destinée à mettre fin à l’ère néolibérale ouverte dans les années 1980. Portée par le slogan « Primero los pobres » (Les pauvres d’abord), la Quatrième Transformation entend recentrer l’action publique sur la justice sociale, l’intérêt général et la souveraineté nationale. Plusieurs programmes sociaux emblématiques ont incarné cette volonté de transformation : Sembrando Vida (Se souvenir de la vie), orienté vers la reforestation et le soutien aux petits producteurs ; Jóvenes Construyendo el Futuro (Les jeunes construisent l’avenir), destiné à intégrer les jeunes dans le monde du travail ; ou encore l’augmentation des bourses scolaires et des pensions pour les personnes âgées. Ces dispositifs ont permis une réduction mesurée de la pauvreté monétaire, comme le montrent les indicateurs du CONEVAL (National Council for the Evaluation of Social Development Policy). Toutefois, leur caractère universel, parfois clientéliste, et leur dépendance aux ressources pétrolières ont suscité de nombreuses critiques, notamment quant à leur efficacité structurelle. Parallèlement, la 4T a aussi mis en avant des projets d’infrastructure d’envergure, comme le Tren Maya, un réseau de chemin de fer censé stimuler le développement dans le sud-est du pays, tout en suscitant la résistance de communautés indigènes expropriées et d’organisations écologistes. Derrière l’ambition affichée de réparer les torts du passé, la logique extractiviste et productiviste reste très présente dans le modèle économique défendu par le gouvernement de gauche. Le pouvoir exécutif s’est également appuyé sur une stratégie discursive de légitimation permanente. Les mañaneras, ces conférences matinales quotidiennes d’AMLO à la télévision et sur les réseaux sociaux et depuis reprise par Claudia Sheinbaum, incarnent une volonté de transparence directe mais aussi de contrôle du récit politique, où la critique est souvent assimilée à une trahison de l’intérêt général.
La victoire d’AMLO en 2018 est considérée comme un tournant historique dans la vie politique mexicaine. En effet, celle-ci met fin à l’alternance entre les trois grandes forces qui dominaient la vie politique mexicaine : le PRI (Parti Révolutionnaire Institutionnel), le PAN (Parti Action Nationale) et le PRD (Parti de la Révolution Démocratique). Le mouvement Morena, fondé par AMLO en 2014, s’est rapidement imposé comme une force hégémonique de la gauche mexicaine, redessinant profondément la géographie électorale du pays. L’article de Willibald Sonnleitner dans les Cahiers des Amériques latines montre bien que cette recomposition politique n’a pas conduit à une polarisation binaire, mais à une fragmentation accrue du système partisan. Le tsunami électoral de 2018 a redéfini les alliances, accentué les contrastes régionaux, et généré des bastions très différenciés selon les couches sociales et culturelles du pays. Morena que l’on peut traduire par le Mouvement de la régénération nationale est ainsi parvenu à capter des électorats historiquement divers allant des classes populaires urbaines aux couches moyennes éduquées, en passant par les zones rurales et les anciens électeurs du PRD ou du PRI. Cette hétérogénéité des suffrages constitue une force électorale, mais aussi une source de tensions internes au mouvement, notamment à l’approche de la succession d’AMLO. Claudia Sheinbaum dans son exercice présidentiel doit composer comme son prédécesseur avec une base sociale variée et les attentes contradictoires de son électorat.
Entre continuité sécuritaire et dérives autoritaires : les paradoxes de la 4T
L’une des promesses centrales d’AMLO lors de sa campagne en 2018 était de mettre fin à la guerre contre le narcotrafic lancée par l’ancien président de droite Felipe Calderón en 2006. Guerre qui a militarisé la sécurité publique au prix de centaines de milliers de morts et disparitions. Seulement, le sexennat d’AMLO n’a pas uniquement poursuivi cette militarisation, il l’a amplifiée. La création de la Guardia Nacional (Garde nationale) en 2019, censée être une force civile, s’est rapidement vue confiée à la direction de l’armée. De plus, à la fin de son mandat, AMLO a considérablement élargi les missions des forces armées : contrôle des ports, sécurité publique, gestion des douanes, construction de projets d’infrastructure comme le Tren Maya, voire distribution de vaccins pendant la pandémie. Cette omniprésence militaire soulignée par plusieurs chercheurs, marque une rupture inquiétante avec l’idéal démocratique d’un pouvoir civil contrôlant les institutions de sécurité. En termes de résultats, les premières données de cette politique sont peu encourageantes. Les taux d’homicides ont stagné à un niveau extrêmement élevé. Les disparitions forcées, notamment dans les États de Jalisco ou Tamaulipas, continuent à alimenter les mobilisations des madres buscadoras, ces mères de disparus qui réclament vérité et justice. La stratégie de sécurité d’AMLO, résumée par son slogan « Abrazos, no balazos » (des câlins, pas des balles), s’est révélée largement symbolique et relève plutôt d’une simple formule de communication politique.
Au-delà de la sécurité, la gouvernance du sexennat a été marquée par une forte concentration du pouvoir autour de la figure présidentielle. Chaque matin, lors de ses mañaneras, AMLO imposait son agenda médiatique, commentait l’actualité, attaquait ses adversaires et réinterprétait les critiques comme autant d’attaques contre le peuple. Cette personnalisation du pouvoir, si elle a contribué à entretenir la popularité du président, s’est faite au détriment des contre-pouvoirs institutionnels. Plusieurs institutions autonomes ont été affaiblies voire paralysées, à commencer par l’Institut national d’accès à l’information (INAI), dont le fonctionnement a été bloqué par l’absence de nominations. D’autres entités indépendantes, comme les agences de régulation de l’énergie ou les organismes électoraux, ont été désignées comme des vestiges du néolibéralisme technocratique et prises pour cibles par l’administration présidentielle. Cette dynamique centralisatrice s’est aussi traduite par une forte défiance envers les organisations de la société civile, les médias indépendants et les instances judiciaires. Des voix critiques issues du féminisme, de l’écologie ou des droits humains ont régulièrement été accusées d’être conservatrices ou manipulées par les élites néolibérales, en contradiction avec le pluralisme démocratique que la 4T prétendait restaurer.
Une transformation inachevée ?
L’un des objectifs centraux de la Cuarta Transformación était de réparer les inégalités sociales profondes qui traversent la société mexicaine. Le gouvernement d’AMLO a mis en place des programmes de transferts sociaux massifs, principalement à destination des jeunes, des personnes âgées et des populations rurales. Selon les chiffres du CONEVAL, ces politiques ont contribué à réduire la pauvreté monétaire entre 2018 et 2022. Mais cette amélioration reste fragile et partielle. Le système de santé public, affaibli par la pandémie et par la disparition du Seguro Popular remplacé par un nouvel organisme, INSABI (Institut national de la santé pour le bien-être), peine à répondre aux besoins des plus vulnérables. Le secteur de l’éducation a également été marqué par une inégalité persistante d’accès aux services éducatifs, notamment dans les zones rurales et marginalisées. Sur le plan économique, la stratégie d’AMLO s’est appuyée sur une forme de néo-développementalisme fondée sur les énergies fossiles (notamment la raffinerie de Dos Bocas), les grands projets d’infrastructures et la relance du rôle de l’État providence. Ce modèle, s’il a permis d’éviter une explosion de la dette publique, s’est révélé peu porteur en termes de transition écologique ou d’innovation sociale, et reste exposé à la volatilité des marchés internationaux. Les logiques extractivistes, dénoncées par de nombreux mouvements indigènes et écologistes, restent finalement centrales dans la matrice économique du gouvernement.
Malgré ces limites, la popularité d’AMLO est restée très élevée tout au long de son mandat. Cette adhésion peut s’expliquer par la capacité du président à incarner une figure de rupture politique et morale avec les élites du passé. Elle s’explique également par un lien direct avec les classes populaires et une lecture simple du monde politique matérialisée par la formule du peuple contre les élites. Toutefois, cette hégémonie reste fragile. L’érosion des institutions démocratiques, la concentration du pouvoir, la difficulté à endiguer la violence ou à proposer un modèle de développement alternatif font peser un lourd risque de désillusion. Claudia Sheinbaum, en héritant de ce projet, doit composer avec un appareil d’État repensé, centralisé, une société civile fragmentée, et une base électorale plurielle. L’élection de 2024 pourrait ainsi marquer un tournant. Si Sheinbaum choisit la continuité autoritaire et extractiviste, la promesse initiale d’une transformation sociale et démocratique risque de s’évaporer. Si elle inaugure une nouvelle séquence fondée sur un récit d’approfondissement démocratique, la Quatrième Transformation pourrait s’imposer comme une matrice féconde de refondation politique, capable d’irriguer les imaginaires des gauches occidentales. C’est en tous cas ce que laisse présager la visite symbolique de Jean-Luc Mélenchon au Mexique en février 2025.
La Quatrième Transformation se voulait une révolution douce, capable de concilier redistribution sociale, souveraineté nationale et démocratie participative. Six ans plus tard, le bilan d’AMLO apparaît ambivalent avec des avancées certaines, mais aussi de fortes inerties structurelles et une gouvernance de plus en plus personnalisée. Le Mexique entre dans une nouvelle phase de son histoire, et l’héritage d’AMLO dépendra autant de ses réformes que de la manière dont ses successeurs sauront ou non transformer l’essai de cette politique.
En refermant cette séquence politique mexicaine, une question persiste : peut-on transformer un État néolibéral sans rompre avec les structures du capitalisme extractiviste et autoritaire ?
Le cas AMLO illustre les espoirs et les limites d’un projet de gauche arrivé au pouvoir avec une forte légitimité populaire, mais rapidement confronté aux compromis de la gouvernance, aux injonctions des marchés, et à l’héritage institutionnel de décennies de libéralisation.
Pour les gauches du monde entier – et notamment en France – ce bilan résonne comme un avertissement et une source d’inspiration. Face à l’extrême droite qui prospère sur les désillusions démocratiques, la gauche ne peut pas se contenter de redistribuer un peu mieux sans transformer les structures profondes de l’économie et du pouvoir.
Le peuple mexicain n’a pas seulement voté pour des aides sociales, mais pour la dignité, la souveraineté, et une promesse d’émancipation. C’est ce désir radical qui doit nourrir les projets des gauches en Europe : refuser l’austérité, rompre avec l’extractivisme, reconstruire la puissance populaire par la démocratie réelle, et faire de l’État l’instrument des communs, non celui de la rente.
À l’heure où s’ébauchent de nouvelles dynamiques de coalition populaire en France, le bilan d’AMLO invite à penser une gauche qui ne se contente plus d’être un correctif social au capitalisme, mais qui trace la voie d’une alternative systémique.
Bibliographie :
Ouvrage :
- COMBES Hélène, De la rue à la présidence : Foyers contestataires à Mexico, Paris, CNRS Éditions, 2024.
Articles scientifiques :
- ALVARADO MENDOZA Arturo, « La seguridad pública y la violencia durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador: Militarismo, criminalidad e imperio de la ley ». Cahiers des Amériques latines, no 104, 2024.
- COSIO ZAVALA Maria Eugenia, BIZBERG Ilan, « Introduction – Le sexennat d’Andrés Manuel López Obrador : bilan et défis ». Cahiers des Amériques latines, no 104, 2024.
- GACHET Nina-Lou, FOYER Jean. « L’interdiction du glyphosate et du maïs transgénique au Mexique : López Obrador et le populisme écologique ». Cahiers des Amériques latines, no 104, 2024.
- LEVY Simon, « La politique minière et énergétique du gouvernement de la Quatrième transformation. Quand l’atténuation de la conflictualité permet l’intensification de l’extractivisme ». Cahiers des Amériques latines, no 104, 2024.
- MELGAR Lucia, TINAT Karine, « Cuatro años de retrocesos y resistencias: Mujeres y movimiento feminista ante el Gobierno de López Obrador ». Cahiers des Amériques latines, no 104, 2024.
- SONNLEITNER Willibald, « Le Mexique s’est-il polarisé ? Changement et continuités d’une géographie électorale plurielle et fragmentée », Cahiers des Amériques latines, no 104, 2024.